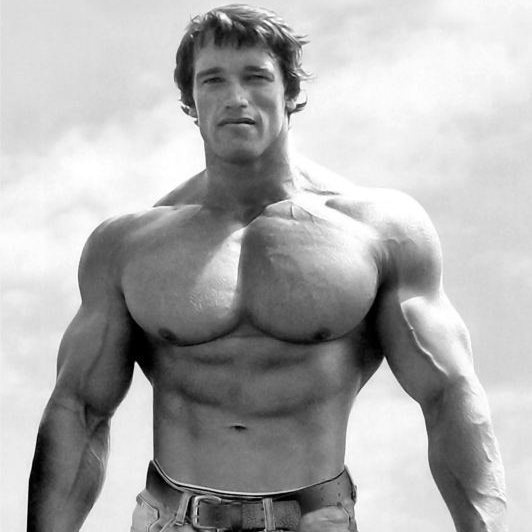Focus sur l'arum : une plante annuelle d'automne

L’arum fascine par son élégance et sa présence dans nos jardins d’automne. Pourtant, il est souvent source de confusion, notamment avec le calla et la zantedeschia, deux autres genres ornementaux proches. Comprendre l’arum, c’est aussi comprendre sa place dans la famille des Aracées, sa diversité botanique, ses exigences de culture et les précautions à prendre face à sa toxicité. Cet article vous propose un focus complet sur cette plante annuelle ou vivace, à la fois décorative et surprenante.
L’arum est une plante ornementale remarquable de l’automne, souvent confondue avec le calla et la zantedeschia. Principalement cultivé pour sa fleur en spathe élégante et ses feuilles décoratives, l’arum apprécie les sols riches et humides, une exposition mi-ombre à ensoleillée, et se décline en plusieurs espèces dont l’arum blanc et l’arum maculatum. Originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie mineure, il fleurit du printemps à l’été selon les variétés. Attention, toutes les parties de l’arum sont toxiques, notamment à cause de l’oxalate de calcium.
La famille des Aracées : un lien botanique commun
L’arum appartient à la grande famille des Aracées, souvent désignée sous le terme anglais arum family dans la littérature botanique. Cette famille regroupe également le calla et la zantedeschia. Ces plantes partagent plusieurs traits morphologiques, dont la fameuse spathe entourant un spadice, une caractéristique florale unique qui séduit de nombreux jardiniers. Leur diversité, tant dans les milieux naturels que dans les jardins, témoigne d’une adaptation remarquable à différents environnements, de la terre ferme aux zones humides.
🚨À retenir :
Pour bien comprendre l’arum, il faut distinguer les trois genres proches : Arum, Calla et Zantedeschia, tous issus de la famille des Araceae mais aux exigences et morphologies différentes. L’arum est une plante vivace ou annuelle selon l’espèce, appréciée pour ses grandes fleurs en spathe et ses feuilles sagittées. Sa culture requiert un sol humide, une bonne protection contre le gel et une attention particulière à sa toxicité, fréquente chez les plantes de la famille des araceae. La confusion avec d’autres espèces, notamment le calla et la zantedeschia, est courante et peut avoir des conséquences en cas d’ingestion accidentelle. Enfin, l’arum joue un rôle écologique particulier grâce à la thermogenèse, un phénomène rare chez les plantes ornementales.
Le genre Arum : diversité et caractéristiques
Origine et répartition géographique des espèces d’arum
Le genre arum compte environ 27 espèces selon le Catalogue of Life. Il est principalement originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie mineure. L’arum maculatum (gouet tacheté) et l’arum italicum figurent parmi les plus répandus dans la flore sauvage européenne. Ces espèces colonisent volontiers les sous-bois, les bords de ruisseaux et les sols riches en humus.
Le genre Arum compte 27 espèces, mais le Calla palustris, souvent confondu avec l’arum, n’en compte qu’une seule, et pousse exclusivement dans les milieux semi-aquatiques comme les tourbières.
Description morphologique : feuilles, fleurs et fruits
Les feuilles de l’arum sont généralement sagittées (en forme de flèche), parfois maculées de taches blanches chez l’arum maculatum. Elles mesurent entre 10 et 55 cm selon l’espèce. La fleur de l’arum se compose d’une grande spathe, le plus souvent blanc verdâtre ou crème, qui entoure un spadice dressé. Après la floraison, la plante produit des grappes de baies rouge-orangé, très voyantes mais hautement toxiques.
La spathe blanche ou colorée de l’arum n’est pas une fleur au sens strict, mais une bractée qui entoure le véritable organe floral, appelé spadice, une curiosité botanique qui séduit les amateurs de plantes rares.
Arum italicum : une espèce emblématique
L’arum italicum (arum d’Italie), parfois référencé dans la littérature sous le nom arum italicum mill, est apprécié pour ses feuilles persistantes veinées de blanc et sa capacité à fleurir à l’ombre. Sa spathe mesure de 15 à 40 cm et sa floraison intervient en juin. Ses baies, très décoratives, virent au rouge vif à maturité.
Arum maculatum et arum tacheté : identification et particularités
L’arum maculatum, aussi appelé gouet tacheté ou arum tacheté, se distingue par ses feuilles ponctuées de taches sombres. Cette plante toxique est fréquemment rencontrée dans les forêts tempérées et figure parmi les espèces les plus connues du genre arum.
Arum creticum : une espèce méditerranéenne
Parmi les espèces remarquables, arum creticum est à mentionner. Originaire de Crète et des régions méditerranéennes, il est apprécié pour sa spathe jaune pâle et sa grande résistance à la sécheresse. L’arum creticum est particulièrement adapté aux jardins secs et rocailleux, où il apporte une touche d’exotisme et de couleur.
Conditions naturelles et habitat de l’arum
L’arum préfère les sols riches, frais à humides, et une exposition à la mi-ombre. Son cycle de vie, souvent annuel ou vivace selon l’espèce, lui permet de s’adapter à de nombreux contextes climatiques, à condition d’éviter le gel intense.
Le genre Calla : une espèce unique et semi-aquatique
Calla palustris : caractéristiques botaniques
Le calla palustris est la seule espèce du genre Calla. Cette plante semi-aquatique se distingue par ses feuilles en forme de cœur et sa spathe blanche ou crème entourant un spadice jaune-verdâtre. Sa floraison s’étale de mai à août.
Habitat naturel et culture en milieu aquatique
Le calla palustris pousse naturellement dans les tourbières, les étangs et autres milieux humides. Il se plaît en bord d’eau ou en bassin, où il apporte une touche élégante et fraîche. Son rhizome doit être planté à 10 cm de profondeur, sous environ 5 cm d’eau.
Conseils de plantation et entretien en bassin
Pour réussir la culture du calla, privilégiez un sol détrempé, riche en matières organiques, et une exposition lumineuse mais non brûlante. Cette plante est idéale pour les jardins aquatiques ou les berges ombragées.
👉 Question fréquente : Pourquoi l’arum est-il parfois appelé calla ou zantedeschia ?
La confusion vient du fait que ces trois genres appartiennent à la même famille botanique, les Araceae, et présentent des fleurs similaires en forme de spathe. Cependant, le calla (Calla palustris) est une plante semi-aquatique unique, tandis que la zantedeschia regroupe plusieurs espèces sud-africaines, souvent appelées "arum blanc" ou "calla blanc" en jardinerie. L’arum, quant à lui, est typique des sous-bois européens.
Le genre Zantedeschia : arum blanc et variétés colorées
Origine sud-africaine et espèces principales
La zantedeschia est un genre originaire d’Afrique du Sud, regroupant 8 espèces. La plus connue, zantedeschia aethiopica, est souvent appelée arum blanc ou calla blanc en raison de sa grande spathe blanche et de sa floraison spectaculaire.
L’arum blanc (Zantedeschia aethiopica) est une plante originaire d’Afrique du Sud, rustique jusqu’à -10°C, ce qui en fait une des rares espèces de la famille des araceae à supporter les hivers tempérés européens.
Zantedeschia aethiopica : description et culture
La zantedeschia aethiopica se distingue par ses feuilles persistantes, vert foncé, et ses grandes spathes blanches pouvant atteindre 20 cm. Sa floraison s’étend du printemps à l’automne. Cette plante apprécie les sols riches, humides et bien drainés, ainsi qu’une exposition ensoleillée ou mi-ombre.
Variétés colorées de zantedeschia : diversité et particularités
Outre le classique blanc, il existe des variétés colorées telles que ‘Black Magic’ (pourpre foncé), ‘Carmine Red’ (rouge intense), ou ‘Picasso’ (rose et crème). Ces cultivars offrent un large éventail de coloris pour agrémenter massifs et bouquets.
Conditions de culture et protection hivernale
La zantedeschia nécessite un arrosage régulier et un paillage en hiver pour protéger ses rhizomes du risque de gel. En région froide, il est conseillé de rentrer les bulbes ou de les couvrir d’un épais manteau de feuilles mortes.
Particularités biologiques de l’arum
Thermogenèse et mécanisme de pollinisation
Certaines espèces d’arum, comme l’arum d’Italie, présentent un phénomène rare : la thermogenèse. L’inflorescence produit de la chaleur et dégage une odeur fécale, attirant ainsi les insectes pollinisateurs (diptères). Cette stratégie assure une pollinisation efficace, même dans les sous-bois humides.
Certaines espèces d’arum, comme l’arum d’Italie, produisent de la chaleur (thermogenèse) et dégagent une odeur fécale pour attirer les insectes pollinisateurs, un mécanisme unique dans le monde végétal !
Odeur et attraction des insectes pollinisateurs
L’arum émet une odeur caractéristique pendant 2 à 3 jours, période durant laquelle les insectes sont temporairement piégés dans la spathe. Contrairement à certaines croyances, l’arum ne digère pas ces insectes.
👉 Question fréquente : L’arum est-il vraiment une plante carnivore ?
Non, malgré la présence d’insectes piégés dans la spathe de certaines espèces comme l’arum d’Italie, la plante ne digère pas ses proies. Ce mécanisme sert uniquement à la pollinisation, les insectes étant libérés ou mourant naturellement sans être assimilés par la plante.
Clarification sur la fausse croyance de la carnivorie
L’absence d’enzymes digestives chez l’arum distingue clairement cette plante des vraies plantes carnivores. Le piégeage des insectes n’a qu’un but : assurer la fécondation.
Conseils pratiques pour la culture et l’entretien de l’arum
Plantation en pleine terre : sol, exposition et période idéale
Pour planter un arum, préparez un trou de 30x30 cm, enrichi de compost, et placez le bulbe à 10-12 cm de profondeur, bourgeon vers le haut (source). Arrosez généreusement après plantation. L’arum blanc apprécie une exposition ensoleillée à mi-ombre et un sol riche, humide mais bien drainé. La plantation se fait idéalement au printemps (mars à mai) ou en automne dans les régions douces.
Entretien en pot : arrosage, rempotage et soins spécifiques
L’arum en pot exige un arrosage quotidien en période de floraison, un bon drainage et une lumière vive sans soleil direct. Coupez les fleurs fanées et rempotez tous les deux ans pour garantir une croissance vigoureuse (source).
Protection contre le gel et hivernage
En climat froid, paillez abondamment ou rentrez les pots à l’abri. Les rhizomes de zantedeschia et d’arum blanc peuvent être déterrés et stockés dans un endroit sec et frais pour éviter les dégâts liés au gel.
Toxicité de l’arum : précautions et risques
Nature de la toxicité : oxalate de calcium et symptômes
L’arum est une plante toxique : toutes ses parties, y compris les feuilles, les baies et les rhizomes, contiennent de l’oxalate de calcium. L’ingestion provoque des irritations buccales, troubles gastro-intestinaux et, dans de rares cas, des œdèmes sévères. Les enfants et animaux domestiques sont particulièrement exposés.
Risques pour les enfants et animaux domestiques
Les intoxications par arum représentent 22 % des cas recensés par les centres antipoison entre 2012 et 2021, la majorité concernant les enfants de moins de six ans (source).
Mesures de prévention et conduite à tenir en cas d’intoxication
Ne jamais consommer une plante inconnue ou confondue avec une autre. En cas d’ingestion suspecte, contactez immédiatement un centre antipoison (01 45 42 59 59). Photographier la plante peut faciliter son identification.
Utilisation ornementale de l’arum
Arum blanc et autres espèces dans le jardin
L’arum blanc (zantedeschia aethiopica) est très apprécié pour ses grandes spathes et son feuillage persistant. Il illumine massifs, bordures et berges humides, tout en s’associant parfaitement à d’autres plantes d’ombre comme les hostas ou les fougères. Le gouet tacheté ou arum tacheté est également utilisé pour ses qualités décoratives dans les jardins naturels.
Associations de plantes pour un effet décoratif harmonieux
Pour un jardin harmonieux, associez l’arum à des astilbes, hémérocalles ou iris, qui partagent des exigences similaires en termes de sol et d’exposition.
| Plante associée | Avantage décoratif | Exposition compatible |
|---|---|---|
| Hostas | Contraste de feuillage | Mi-ombre |
| Astilbes | Floraison plumeuse | Ombre / Mi-ombre |
| Fougères | Ambiance boisée | Ombre |
| Iris | Floraison simultanée | Soleil / Mi-ombre |
Arum en bouquet : tenue et valorisation florale
La fleur d’arum est très prisée en art floral pour sa tenue en bouquet et son élégance intemporelle. Les variétés colorées permettent de composer des arrangements originaux du printemps à l’automne.
Le genre Arum compte 27 espèces, mais le Calla palustris, souvent confondu avec l’arum, n’en compte qu’une seule, et pousse exclusivement dans les milieux semi-aquatiques comme les tourbières.
Pour aller plus loin : références et ressources
Pour approfondir vos connaissances sur l’arum et ses proches, la référence de Deni Bown, spécialiste des Aracées et auteur du livre "Aroids: Plants of the Arum Family" chez Timber Press, est incontournable. Ce livre, largement cité sur chaque site web spécialisé en botanique, offre une analyse détaillée de chaque espèce, de leur biologie à leur culture, et met en lumière des espèces moins connues comme l’arum creticum ou l’arum italicum mill.
Conclusion : L’arum, une plante d’automne aux multiples facettes à découvrir
L’arum se distingue par sa beauté, sa diversité et ses particularités biologiques fascinantes, comme la thermogenèse. Sa culture requiert quelques précautions, notamment face à sa toxicité, mais il reste un atout majeur pour tout jardinier passionné. Que vous optiez pour l’arum blanc, l’arum maculatum, l’arum creticum ou une variété colorée de zantedeschia, cette plante ornementale saura embellir vos espaces, du bassin à la pleine terre, tout en offrant un spectacle unique du printemps à l’automne.
Questions fréquentes
Comment différencier un arum, un calla et une zantedeschia au jardin ?
La distinction repose d’abord sur l’habitat naturel et la morphologie. L’arum (genre Arum) présente des feuilles sagittées souvent veinées de blanc et une spathe verdâtre à blanche, avec des baies rouges à maturité. Le calla (Calla palustris) est une espèce unique de milieux humides, avec des feuilles en forme de cœur et une inflorescence discrète. Enfin, la zantedeschia, souvent vendue comme 'arum blanc', se reconnaît à ses grandes spathes blanches ou colorées et ses feuilles persistantes, parfois tachetées de blanc. En résumé, observez la forme des feuilles, la couleur et la taille de la spathe, et l’habitat pour une identification fiable.
Quelles sont les précautions à prendre avec un arum dans un jardin familial ?
L’arum est une plante toxique du fait de la présence d’oxalate de calcium dans toutes ses parties. Il est donc essentiel de la planter hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques, qui pourraient être tentés de goûter ses feuilles ou ses baies colorées. En cas d’ingestion, contactez immédiatement un centre antipoison. Par ailleurs, il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation des bulbes ou de la taille, afin d’éviter toute irritation cutanée, et de bien se laver les mains après le jardinage.
Comment réussir la culture de l’arum en pleine terre et obtenir une floraison spectaculaire ?
Pour favoriser une floraison abondante, choisissez un emplacement ensoleillé à mi-ombragé, dans un sol riche, frais et bien drainé. Plantez les bulbes ou rhizomes à 10-20 cm de profondeur au printemps ou à l’automne selon les variétés, en espaçant de 30 à 40 cm chaque plant. Arrosez généreusement, surtout en période de croissance, et apportez un engrais équilibré au printemps. Protégez les bulbes du gel en paillant le sol ou en les déterrant dans les régions très froides. Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison et divisez les touffes tous les 2-3 ans pour revitaliser la plante.
Quels sont les usages ornementaux et écologiques de l’arum ?
L’arum est très apprécié pour sa grande valeur ornementale dans les massifs, les bordures ou en pot, notamment grâce à ses spathes blanches ou colorées qui apportent une touche d’élégance au jardin. Il est aussi utilisé en bouquet, du fait de la tenue exceptionnelle de ses fleurs coupées. Sur le plan écologique, certaines espèces participent à la biodiversité locale en attirant des insectes pollinisateurs grâce à leur mécanisme de thermogenèse. Toutefois, sa toxicité impose une vigilance particulière dans les espaces publics ou partagés.
Sommaire